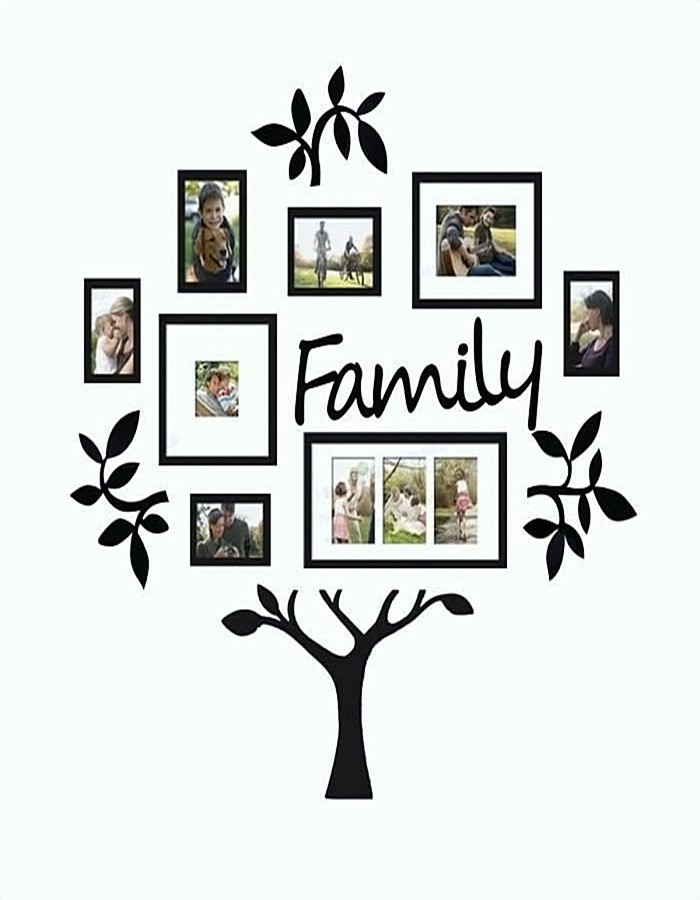Berger
Sous l'ancien régime
Le métier de berger ne se résumait pas à surveiller les moutons en sifflotant sous un pommier. Aidé de chiens, le berger guidait les troupeaux de moutons, parfois les « bêtes rouges » (vaches et bœufs), — dans ce cas il prenait le nom de pâtre le long de chemins herbeux appelés « chemins verts » ou « chemins aux bœufs ».
Statut social : le berger était un employé communal ou seigneurial. Dans beaucoup de villages, il existait un berger communal ou pâtre engagé collectivement par la communauté villageoise pour mener paître les troupeaux des habitants. Chaque famille payait une contribution, en argent, en grains ou en nature.
Privilèges et interdits : sous l’Ancien Régime, la pâture était régie par la vaine pâture : après les récoltes, tout le monde avait le droit de mener ses bêtes sur les terres moissonnées. Mais en période de culture, le berger devait respecter des règles strictes, sous peine d’amendes prévues par les règlements seigneuriaux.
Lien au seigneur : souvent, le berger dépendait directement de la seigneurie. Il pouvait avoir droit à un logement, à une petite terre attenante ou à des privilèges, mais restait d’un rang modeste, parfois suspecté de « maraude » ou de sorcellerie (les bergers vivaient à l’écart, dans les champs).
Après la Révolution
Avec la Révolution et la fin des droits féodaux, tout change.
Disparition progressive de la vaine pâture : le partage des communaux et l’essor des enclosures restreignent les espaces où mener les bêtes. Le métier perd son caractère collectif pour devenir davantage une affaire privée (chaque propriétaire gère son troupeau).
Réglementation : le Code rural (début XIXe) fixe les règles de pacage, limite la divagation et oblige les bergers à plus de discipline (gardiennage, responsabilité en cas de dégâts).
Vie quotidienne : le berger reste un homme du dehors, vêtu de gros drap, souvent avec un manteau de bure, un bâton (houlette) et parfois aidé de chiens dressés. Il vit au rythme des saisons, parfois seul, parfois avec les troupeaux rassemblés de plusieurs exploitants.
Métiers associés : certains bergers pratiquent la tonte, la fabrication de fromages ou la vente de laine, ce qui diversifie leurs revenus.
Le regard des villageois
L'homme était apprécié pour son savoir : ilpossédait ce qu’on pourrait appeler quelques connaissances vétérinaires : soigner un sabot abimé, une patte écorchée, quelques maladies simples, aider au vêlage ou à l’agnelage ;
Dans le même temps il intriguait. Familiarisé avec les herbes et les fleurs des bois et des prés, sa connaissance des « simples » et des animaux, sa solitude, le ciel et les astres lui faisaient attribuer assez souvent des talents de guérisseur, de rebouteux, et un peu de sorcier.

Merci pour cette lecture. L' article vous a ému(e), intéressé(e), amusé(e) ou tout simplement été utile ?
Ecrivez-moi un petit commentaire, Seul le nom (initiales ou pseudo) est obligatoire. Si vous souhaitez que je vous contacte, pensez-à renseigner votre e-mail, je suis toujours heureuse d'échanger.
Le blog ne comporte pas de bouton « like » n’hésitez donc pas à manifester votre satisfaction en attribuant les cinq étoiles ci-dessous. C’est une belle façon d’encourager mon travail !
Date de dernière mise à jour : Mer 17 sept 2025
Ajouter un commentaire