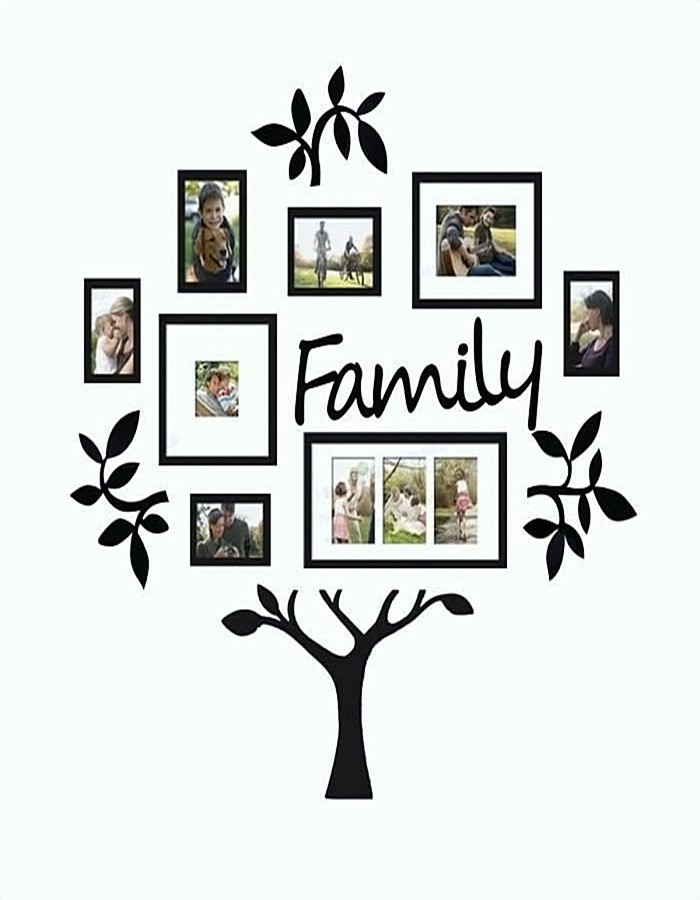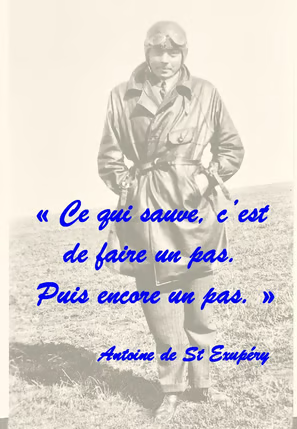Georges Delfosse, un pionnier (1889-1923)
Un enfant de Bertry
Georges naît à Bertry en 1889, dans une modeste maison où le battement des métiers à tisser rythme les journées d’un père tisserand, Paul Delfosse. À ses côtés, Marie Lentier, sa mère, incarne une figure rare et précieuse pour l’époque : institutrice. Elle fait partie de ces femmes qui, dès la fin du XIXe siècle, ont porté avec détermination les valeurs de la République naissante dans les campagnes françaises. Comme une « hussarde noire» Marie Lentier enseigne, transmet, et trace une voie dans un monde où les femmes restent souvent reléguées à l’ombre des hommes.
De l’union de Paul et Marie naîtront six enfants, dont une petite fille emportée trop tôt par la maladie. Parmi eux, deux noms resteront gravés dans la mémoire des Bertrésiens : Arthur, père du général Guy Delfosse, et Pauline, qui choisira, comme sa mère, de se consacrer à l’enseignement. Georges, lui, rêvera d’horizons plus lointains.
Employé de bureau lors de son conseil de révision en 1909, il rejoint l’armée l’année suivante.
L’appel des armes et l’épreuve du feu
Incorporé en 1910 comme soldat de 2ᵉ classe, Georges Delfosse gravit rapidement les échelons : brigadier en 1911, maréchal des logis en 1912. Son engagement ne faiblit pas. En 1913, il se réengage, choisissant définitivement la carrière militaire. À cette époque, l’Europe s’enlise dans les tensions, mais personne ne pressent encore l’ampleur du cataclysme à venir. La guerre, elle, frappera à sa porte bien plus tôt que quiconque ne l’imagine.
Le courage de Mourmelon Le 16 septembre 1914, la Champagne tremble sous les obus. À Mourmelon, le sol se déchire, les éclats sifflent, la mort rôde. Georges, touché au bras gauche par un éclat d’obus, sent le sang couler. Pourtant, il ne recule pas. Autour de lui, le chaos : deux conducteurs sont blessés, trois chevaux gisent, fauchés net. Mais Georges, malgré la douleur, garde la tête froide. D’une voix ferme, il réorganise ses hommes, ramène personnel et matériel sur la position de la batterie. Ce n’est qu’une fois sa mission accomplie, une fois ses soldats en sécurité, qu’il accepte enfin de se laisser évacuer.
Cet acte de bravoure ne passe pas inaperçu. Il lui vaut une citation à l’ordre de la division et la Croix de guerre avec étoile d’argent, avec ces mots, gravés dans l’histoire de son régiment : « Soldat brave, courageux et très consciencieux... Quoique sérieusement blessé, n’a consenti à se faire évacuer qu’après avoir ramené tout son personnel sur la position de la batterie »
Des tranchées aux ailes : une métamorphose
D’abord déclaré inapte à faire campagne, Georges Delfosse refuse de baisser les bras. En octobre 1915, sa détermination paie : il est révisé et maintenu à l’activité. La guerre, elle, continue de forger son destin. En février 1916, il est promu adjudant et passe de l’infanterie à l’artillerie, comme si le sort le préparait déjà à de plus hauts horizons.
Car un nouveau front s’ouvre : le ciel. En mars 1918, il rejoint le 1er régiment d’aviation. Le 15 juillet, il foule le sol de l’école d’aviation de Vineuil. Ce même jour, il est déclaré pilote. Le 1er septembre, il obtient son brevet (n°15 605). Et dès le lendemain, le voilà moniteur de vol, chargé de former les futures ailes de l’armée française.
En quelques semaines à peine, le soldat des tranchées, marqué par la boue et le feu, se transforme en instructeur des airs. Une ascension aussi rapide qu’inattendue, symbole d’une époque où la guerre propulse les hommes vers des destins qu’ils n’auraient jamais imaginés.
L’homme derrière l’uniforme
La paix revenue, Georges Delfosse peut enfin se projeter dans l’avenir. Il épouse Rachel Désirée Villepoux, sœur de Berthe Isabelle, l’épouse de son frère Arthur. Une histoire presque romanesque : les deux frères, avaient trouvé en leurs marraines de guerre les compagnes de leur existence. De l’union de Georges et Rachel naît, en 1920, une fille prénommée Paule. Mais la destinée, déjà, se profile à l’horizon, sombre et imprévisible.
Après l’armistice, Georges se réengage pour deux ans. Comment aurait-il pu faire autrement ?
Lui qui avait, un jour, goûté à l’ivresse du ciel, ne pouvait plus se résoudre à rejoindre le plancher des vaches. Affecté à Ambérieu, il y poursuit sa carrière de pilote militaire. Lorsque son unité est dissoute, il rejoint le 3ᵉ régiment d’aviation de chasse. Le 4 juillet 1923, à seulement 34 ans, il est nommé adjudant-chef pilote devant le sous-intendant militaire de Châteauroux. La vie semble lui sourire : il a le ciel pour horizon, une famille pour ancrage, et l’avenir pour promesse. Un chemin tout tracé. Mais le destin, capricieux, n’aime pas les lignes trop droites.
Le dernier vol
Octobre 1923. Le 3ᵉ régiment d’aviation de chasse vient de recevoir ses nouveaux Nieuport-Delage NiD-29, des appareils rapides, mais exigeants. Les pilotes s’entraînent sans relâche à en maîtriser les subtilités. Deux jours plus tôt, un aviateur a déjà perdu la vie dans des circonstances troublantes, après un décrochage en basse altitude.
Le 30 octobre, sur le camp de La Martinerie, près de Châteauroux, Georges Delfosse décolle à son tour pour un vol d’entraînement. Les détails précis de l’accident se perdront dans le vent : on sait seulement que son avion, lui aussi, décroche brutalement. Trop bas pour permettre une reprise, le NiD-29 s’écrase après une chute de cinquante mètres.
Les blessures sont fatales : fracture du crâne, contusions généralisées. Transporté en urgence à l’infirmerie du camp, Georges Delfosse succombe quelques minutes plus tard.
Hommage aux pionniers du ciel
Georges Delfosse appartenait à cette génération de pionniers pour qui la guerre des tranchées ne fut qu’un prélude à une autre conquête : celle, vertigineuse, du ciel. Ils furent les artisans d’un rêve fou, les dompteurs du vent et du vide, ces hommes qui, à peine sortis de l’enfer de la boue, choisirent de défier l’azur.
À peine plus jeune que Roland Garros, d’une décennie l’aîné des Mermoz et Saint-Exupéry, il incarnait cette race d’aviateurs pour qui voler n’était ni une témérité, ni une prouesse, mais une évidence. Ils connaissaient le risque, le mesuraient chaque jour, et pourtant, ils décollaient. Parce que le vol, pour eux, était bien plus qu’une technique : une communion avec la machine, une quête de lumière, une façon d'affronter l’impossible.
Beaucoup tombèrent avant que le monde ne retienne leurs noms. Leur sacrifice, leurs ailes brisées, ouvrirent à l’humanité des horizons que nul n’osait imaginer. Leur courage ne se mesure pas aux records ou aux médailles, mais à cette trace indélébile qu’ils ont laissée dans le ciel : la promesse d’un futur où l’homme, enfin, pourrait tutoyer les nuages.
Encadré technique : Le Nieuport-Delage NiD-29 et ses défis
Un grand merci à Marc_91 et aux membres du forum Aviation Ancienne pour leur aide précieuse depuis les débuts de ce blog. Leurs connaissances pointues et leurs archives — notamment les photos d’accidents similaires — ont été déterminantes pour reconstituer avec exactitude le contexte des vols de Georges Delfosse.
Un avion prometteur, mais exigeant
Le Nieuport-Delage NiD-29, distribué aux unités à partir de 1922, représentait un bond en avant par rapport au SPAD XIII. Plus puissant, il était cependant près de 300 kg plus lourd, ce qui en modifiait radicalement le comportement en vol, surtout lors des manœuvres à basse vitesse ou en virage serré. Sa sensibilité aux décrochages en fit un appareil redoutable pour les pilotes en phase d’adaptation.
Une transition périlleuse
Première unité équipée, le Groupe de Chasse 15 stationné en Allemagne inaugura l’ère du NiD-29. Dès 1923, une décision fut prise : ce chasseur deviendrait le seul en service dans l’Aéronautique Militaire. Les escadrilles des 1er et 3ème Régiments de Chasse (Thionville et Châteauroux) furent parmi les premières à convertir entièrement leur flotte. Pour des aviateurs rompus au SPAD XIII, plus léger et réactif, l’apprentissage des subtilités du NiD-29 s’avéra semé d’embûches.
Un tribut lourd
Les accidents d’octobre 1923 à La Martinerie — dont celui, fatal, de Georges Delfosse, survenu deux jours après un premier crash aux causes identiques — soulignent les risques de cette transition. Les décrochages en basse altitude, souvent sans issue, devinrent le danger majeur d’une époque où chaque vol était une leçon, parfois au prix fort.

Merci pour cette lecture. L' article vous a ému(e), intéressé(e), amusé(e) ou tout simplement été utile ?
Ecrivez-moi un petit commentaire, Seul le nom (initiales ou pseudo) est obligatoire. Si vous souhaitez que je vous contacte, pensez-à renseigner votre e-mail, je suis toujours heureuse d'échanger.
Le blog ne comporte pas de bouton « like » n’hésitez donc pas à manifester votre satisfaction en attribuant les cinq étoiles ci-dessous. C’est une belle façon d’encourager mon travail !
Date de dernière mise à jour : Dim 19 oct 2025
Ajouter un commentaire